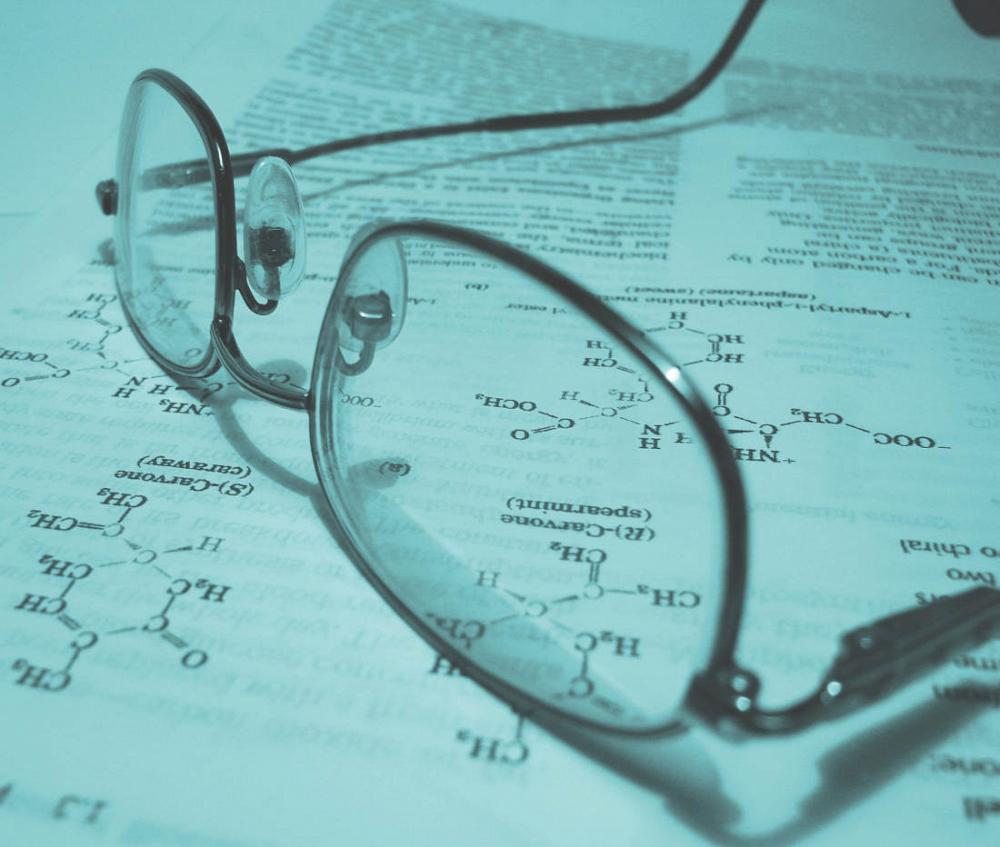- Accueil
- Projets de recherche
- OPUR6 : 2024-2029
- Thème R2 : Gestion décentralisée des eaux urbaines dans un contexte de changement
- Axe R2.1 : Hydrologie de la gestion à la source des eaux pluviales – de l’ouvrage à la ville
Action R2.1.4 : Orienter la conception des ouvrages de biorétention
publié le , mis à jour le
Contacts :
Marie-Christine Gromaire
Jérémie Sage
Contexte
Le terme « biorétention » désigne des ouvrages de gestion à la source du ruissellement urbain basés sur l’infiltration des eaux de ruissellement collectées dans une dépression superficielle du sol, suivie de leur percolation au travers d’une ou plusieurs couches de substrat végétalisé. Il englobe des ouvrages tels que les jardins de pluie, les noues filtrantes, etc.
En favorisant le stockage d’eau dans le sol, son évapotranspiration ultérieure et, quand le contexte le permet, l’exfiltration vers le sous-sol, il contribue à la restauration d’un bilan hydrologique plus naturel, soutient la végétalisation urbaine et les co-bénéfices qu’elle apporte. Par ailleurs, la percolation au travers de couches de substrat aux propriétés contrôlées permet la filtration des polluants particulaires et l’adsorption des polluants dissous, et favorise le développement de communautés microbiennes actives dans la dégradation des polluants organiques piégés.
Ce terme générique de « biorétention » recouvre une grande diversité de conceptions possibles (étanchéité, couches de drainage, alimentation...). Si le concept de biorétention est largement adopté à l’étranger et commence à se répandre en France, les connaissances et outils permettant d’adapter la conception du système au contexte local et maximiser la performance attendue du système restent insuffisants.
Objectifs
L’objectif de cette action est de mettre en place un cadre de modélisation permettant d’orienter les choix de conception (faut-il ou non, un drain, une couche de stockage interne, un revêtement étanche) et de relier la performance hydrologique des ouvrages de biorétention à différents paramètres clefs de contexte (nature du sol sous-jacent), de conception (nature et épaisseur des couches filtrantes) et de dimensionnement (rapport de surfaces bassin versant / ouvrage, volume de stockage, …).
Résultats attendus et retombées
Il s’agit de construire une base étendue de simulations qui permettront :
- De développer un ensemble des recommandations quant à la conception des ouvrages
- De fournir le support au développement d’un outil (métamodèle) d’aide au dimensionnement.